|
Bülent Ecevit, de la légende de « Karaoglan » au retour de la blanche colombe.

Bülent Ecevit est mort, le 5 novembre 2006, dans un hôpital militaire d'Ankara où il était hospitalisé depuis plusieurs mois à la suite d'une attaque cérébrale. Traducteur de T.S. Eliot et Rabindranath Tagore, poète à ses heures, il ne sera jamais attiré, comme beaucoup de ses homologues turcs, par le monde des affaires. Cela lui évitera d'être éclaboussé par des scandales et lui permettra de bénéficier tout au long de sa carrière d'une réputation de grande honnêteté. Il mènera en effet une existence modeste aux côtés de son épouse Rahsan qui restera sa compagne pendant plus de soixante ans et à laquelle on reprochera souvent une trop forte implication dans les choix politiques de son mari. Celui dans lequel la presse laïque turque voit aujourd'hui un « chevalier romantique » (Romantik sövalye) pouvait néanmoins se montrer très autoritaire, notamment quand il s'agissait de combattre la dissidence dans ses propres rangs. Il sera, en tout cas, au cours de la seconde moitié du XXème siècle, le représentant le plus symptomatique d'une gauche kémaliste, nationaliste et volontiers tiers-mondiste. Toutefois, sa longévité et sa participation aux grands moments de l'histoire turque des dernières décennies en font une personnalité dont popularité transcende largement les clivages politiques traditionnels. C'est sans doute la raison pour laquelle, fait exceptionnel, la Turquie a décidé de lui rendre hommage par des obsèques nationales.
Une jeunesse kémaliste
Né en 1925 à Istanbul, fils d’un professeur de médecine déjà député du Parti républicain du peuple (CHP), élève au Robert’s College sur le Bosphore, il reçoit d’abord l’éducation classique des élites républicaines kémalistes, faisant par la suite des études de littérature anglaise, d’histoire de l’Art, de sanskrit et de bengali, non seulement en Turquie mais aussi en Angleterre et aux Etats-Unis, avant de commencer une carrière de journaliste dans les médias officiels. Après la victoire des Démocrates aux élections législatives de 1950, il entre dans la presse d’opposition kémaliste, devient député CHP lors des élections législatives de 1957 et prend la tête des instances régionales de son parti dans la région minière de Zonguldak. Réélu parlementaire constamment au cours des années 60, il est ministre du travail du gouvernement Inönü (1961-1965) et se distingue alors en menant une politique de développement des droits sociaux permettant notamment la reconnaissance véritable du droit de grève en Turquie. Dès cette époque, il apparaît comme le chef de file de l’aile gauche du parti kémaliste dont il prétend incarner le renouveau et dont il devient secrétaire général à partir de 1966. Ayant démissionné de ce poste pour protester contre l’appui d’Ismet Inönü et de la vieille garde kémaliste du CHP à l’intervention militaire de 1971, il succède à ce dernier à la direction du parti l’année suivante.
Les grandes années de « Karaoglan »
Alors même qu’il a refusé de soutenir le gouvernement de techniciens dirigé par Nihat Erim mis en place par les militaires, il critique sévèrement l’implication de l’armée dans la vie politique avant de remporter brillamment les élections législatives de 1973. Ce succès est probablement la plus grande victoire de la gauche (pour ne pas dire l’une de ses seules vraies victoires) dans la longue histoire électorale de la Turquie (33,3% de voix, 185 sièges) mais il ne donne pas au CHP une majorité absolue au Parlement, ce qui l’oblige à former un gouvernement de coalition avec le Parti du Salut National (MSP) de Necmettin Erbakan, autre vainqueur du scrutin de 1973 (11,8%, 48 sièges). Cette alliance avec cette formation islamisante, peut paraître aujourd’hui surprenante et fut souvent reprochée par la suite à Bülent Ecevit. Dans le contexte de l’époque, elle s’explique essentiellement par deux facteurs. D’une part, elle apparaît comme la seule solution immédiate pour gouverner, l’idée d’une grande coalition avec le parti de la Justice (droite conservatrice) étant difficilement concevable, d’autre part, elle n’est pas en totale contradiction avec les orientations des « pré-islamistes » du MSP qui, parce qu’ils sont hostiles à l’intégration européenne, défendent l’économie nationale et se font les porte-parole de la petite bourgeoisie anatolienne face au grand capitalisme urbain, « flirtent » alors plus souvent avec le socialisme qu’avec le libéralisme économique. Mais ce nouveau gouvernement se trouve immédiatement confronté au redoutable défi du premier choc pétrolier dont les effets sont amplifiés par les sanctions économiques qui frappent la Turquie après son intervention militaire à Chypre en 1974. Dès 1975, Bülent Ecevit doit ainsi laisser la place à Suleyman Demirel qui gouverne en s’appuyant sur une coalition dite de « Front nationaliste » principalement animée par le Parti de la Justice et le MSP qui a changé de camp. Aux élections de 1977, le CHP est à nouveau le premier parti turc en voix et en sièges mais n’ayant toujours pas de majorité absolue, Bülent Ecevit n’est pas en mesure cette fois de former un gouvernement durable et doit à nouveau s’effacer devant Suleyman Demirel. Il ne redeviendra Premier ministre que plus tard, entre janvier 1978 et octobre 1979 (au terme de transactions politiciennes laborieuses qui lui sont encore reprochées aujourd’hui) alors même que la Turquie est en train s’enfoncer dans une crise politique, économique et sociale sans précédent.
Leader incontesté de la gauche turque qui s’affirme à cette époque face à Süleyman Demirel, son grand rival de la droite libérale conservatrice, Bülent Ecevit apparaît comme une figure marquante des années 70. L’audience politique qui est alors la sienne témoigne de l’importance prise par les travailleurs salariés dans les zones urbanisées de ce pays et se trouve en phase avec le phénomène « gauchiste » que les universités turques connaissent alors à l’instar de leurs homologues occidentales. C’est à ce moment-là qu’il gagne son surnom de « Karaoglan » qui le suivra pendant toute sa carrière politique, en référence à un héro populaire turc qui n’hésite pas à combattre seul et avec panache un adversaire plus fort que lui. Toutefois, sa décision audacieuse d’intervenir à Chypre ajouté à ses postures anti-impérialistes qui le verront aussi en 1974 supprimer l’interdiction de la culture de l’opium quelques mois après que les Américains l’ait obtenue d’un précédent gouvernement, contribueront à brouiller son pays avec ses alliés occidentaux et au bout du compte à éloigner ce dernier de l’Europe au moment même où d’autres pays du sud méditerranéen s’en rapprochent. Quant à ses stratégies politiques internes inconstantes, elles l’amèneront à deux reprises à former des coalitions gouvernementales au programme ambitieux mais à la durée de vie précaire. Ces échecs et les déceptions qui s’ensuivront lui confèrent sans doute une part de responsabilité dans le chaos politique et social qui s’installe en Turquie à la fin des années 70 et qui sera à l’origine du coup d’État de 1980.
Le retour de la blanche colombe
Assigné à résidence après cette nouvelle intervention militaire, il se voit interdit de fonctions politiques comme les principaux dirigeants turcs du moment et connaît comme eux une longue traversée du désert. Celle-ci ne prend fin qu’avec le référendum de 1987 qui efface les dernières séquelles du coup d’État. Entre temps, refusant de rallier le Parti social-démocrate populiste (SHP) formation, créée entre autres par Erdal Inönü, qui restaurera le parti kémaliste dans les années 80 avant que ce dernier ne reprenne son ancienne dénomination de « CHP » dans les années 90, il crée une autre formation qui se veut plus à gauche, résolument laïque et modérément européenne, le Parti démocrate de gauche (DSP). Clin d’œil au passé anti-impérialiste et parfois pacifiste de son leader, ce parti prend comme insigne une colombe blanche (Ak güvercin) sur fond bleu.
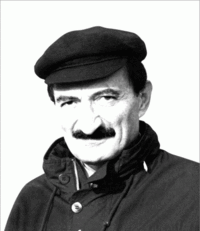 Chemin faisant, bien qu’il ait pu paraître définitivement marginalisé à la fin des années 80, Bülent Ecevit va progressivement revenir, au cours de la décennie qui va suivre, au cœur d’une vie politique turque dont il connaît toutes les arcanes. Son parti entre ainsi au Parlement en 1991 avant de devancer (14,06% des voix et 76 sièges) le CHP à gauche, lors des élections législatives de 1995, remportées par les islamistes du Refah. Après « le coup d’État post-moderne » et la démission en 1997 du gouvernement dirigé par l’islamiste Necmettin Erbakan, le gouvernement de coalition des partis laïques dirigé par Mesut Yilmaz, dans lequel Bülent Ecevit est vice-premier ministre, est discrédité par les scandales et lui aussi congédié en 1998. Appelé à la tête d’un gouvernement de transition par son vieux rival Süleyman Demirel qui est devenu président de la République en 1993, Bülent Ecevit représente en quelque sorte la dernière carte du camp laïque alors que la crise économique s’aggrave et qu’un retour des islamistes commence à se profiler. Après l’arrestation en février 1999 du leader kurde, Abdullah Ocalan, considéré à cette époque comme « l’ ennemi public numéro un » et alors même que l’Union Européenne s’apprête à reconnaître enfin à la Turquie une vocation de candidate, Bülent Ecevit connaît une croissance de sa popularité qui n’est pas sans rappeler celle qui avait été la sienne dans les années 70. Lors des élections d’avril 1999, son parti est ainsi, avec 21,29% des voix, le premier parti de Turquie. Mais, à 75 ans, celui qui apparaît comme l’un des plus vieux routiers de la politique turque, est-il vraiment l’homme de la situation ? À nouveau, il se résout à une alliance hasardeuse et dirige un gouvernement de coalition qui l’associe au MHP, le parti d’extrême droite fondé par le Général Türkes, qui est en fait l’autre vainqueur (avec 17,25% des voix) des élections de 1999. Si certains lui reprochent aujourd’hui cette alliance surprenante, d’autres lui reconnaissent le mérite d’avoir maintenu dans le système cette force extrémiste et d’avoir contribué par là même à pacifier la vie politique turque. Toutefois, malgré les réformes importantes engagées pour favoriser l’intégration européenne de son pays et de la caution technique qu’apporte à son gouvernement la participation de l’ancien vice-président de la Banque mondiale, Kemal Dervis, Bülent Ecevit, diminué par la maladie, échoue dans son entreprise de stabilisation économique et de lutte contre la corruption. Les derniers mois de son gouvernement, qui voient son propre parti secoué par des dissensions internes, sont particulièrement difficiles et mettent sa coalition dans l’impossibilité de relever le défi que constitue désormais l’avènement de l’AKP. Les élections législatives de novembre 2002 qui voient la victoire sans appel de Recep Tayyip Erdogan sont une véritable sanction pour les partis au pouvoir et notamment pour le DSP qui n’obtient que 1,22% des voix. Le CHP, grand rival à gauche du DSP, est en dehors de l’AKP (avec un score de 19,39%) le seul parti représenté à la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Cet ultime revers écarte définitivement du pouvoir et de la vie politique ce leader charismatique dont la casquette et la moustache légendaires hantaient l’arène politique turque depuis plus de quarante ans. Chemin faisant, bien qu’il ait pu paraître définitivement marginalisé à la fin des années 80, Bülent Ecevit va progressivement revenir, au cours de la décennie qui va suivre, au cœur d’une vie politique turque dont il connaît toutes les arcanes. Son parti entre ainsi au Parlement en 1991 avant de devancer (14,06% des voix et 76 sièges) le CHP à gauche, lors des élections législatives de 1995, remportées par les islamistes du Refah. Après « le coup d’État post-moderne » et la démission en 1997 du gouvernement dirigé par l’islamiste Necmettin Erbakan, le gouvernement de coalition des partis laïques dirigé par Mesut Yilmaz, dans lequel Bülent Ecevit est vice-premier ministre, est discrédité par les scandales et lui aussi congédié en 1998. Appelé à la tête d’un gouvernement de transition par son vieux rival Süleyman Demirel qui est devenu président de la République en 1993, Bülent Ecevit représente en quelque sorte la dernière carte du camp laïque alors que la crise économique s’aggrave et qu’un retour des islamistes commence à se profiler. Après l’arrestation en février 1999 du leader kurde, Abdullah Ocalan, considéré à cette époque comme « l’ ennemi public numéro un » et alors même que l’Union Européenne s’apprête à reconnaître enfin à la Turquie une vocation de candidate, Bülent Ecevit connaît une croissance de sa popularité qui n’est pas sans rappeler celle qui avait été la sienne dans les années 70. Lors des élections d’avril 1999, son parti est ainsi, avec 21,29% des voix, le premier parti de Turquie. Mais, à 75 ans, celui qui apparaît comme l’un des plus vieux routiers de la politique turque, est-il vraiment l’homme de la situation ? À nouveau, il se résout à une alliance hasardeuse et dirige un gouvernement de coalition qui l’associe au MHP, le parti d’extrême droite fondé par le Général Türkes, qui est en fait l’autre vainqueur (avec 17,25% des voix) des élections de 1999. Si certains lui reprochent aujourd’hui cette alliance surprenante, d’autres lui reconnaissent le mérite d’avoir maintenu dans le système cette force extrémiste et d’avoir contribué par là même à pacifier la vie politique turque. Toutefois, malgré les réformes importantes engagées pour favoriser l’intégration européenne de son pays et de la caution technique qu’apporte à son gouvernement la participation de l’ancien vice-président de la Banque mondiale, Kemal Dervis, Bülent Ecevit, diminué par la maladie, échoue dans son entreprise de stabilisation économique et de lutte contre la corruption. Les derniers mois de son gouvernement, qui voient son propre parti secoué par des dissensions internes, sont particulièrement difficiles et mettent sa coalition dans l’impossibilité de relever le défi que constitue désormais l’avènement de l’AKP. Les élections législatives de novembre 2002 qui voient la victoire sans appel de Recep Tayyip Erdogan sont une véritable sanction pour les partis au pouvoir et notamment pour le DSP qui n’obtient que 1,22% des voix. Le CHP, grand rival à gauche du DSP, est en dehors de l’AKP (avec un score de 19,39%) le seul parti représenté à la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Cet ultime revers écarte définitivement du pouvoir et de la vie politique ce leader charismatique dont la casquette et la moustache légendaires hantaient l’arène politique turque depuis plus de quarante ans.
Prof. Dr. Jean Marcou
Responsable de l’Observatoire de la Vie Politique Turque (OVIPOT)
6 novembre 2006
|










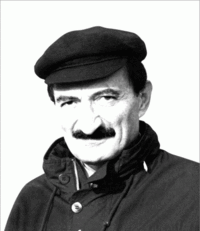 Chemin faisant, bien qu’il ait pu paraître définitivement marginalisé à la fin des années 80, Bülent Ecevit va progressivement revenir, au cours de la décennie qui va suivre, au cœur d’une vie politique turque dont il connaît toutes les arcanes. Son parti entre ainsi au Parlement en 1991 avant de devancer (14,06% des voix et 76 sièges) le CHP à gauche, lors des élections législatives de 1995, remportées par les islamistes du Refah. Après « le coup d’État post-moderne » et la démission en 1997 du gouvernement dirigé par l’islamiste Necmettin Erbakan, le gouvernement de coalition des partis laïques dirigé par Mesut Yilmaz, dans lequel Bülent Ecevit est vice-premier ministre, est discrédité par les scandales et lui aussi congédié en 1998. Appelé à la tête d’un gouvernement de transition par son vieux rival Süleyman Demirel qui est devenu président de la République en 1993, Bülent Ecevit représente en quelque sorte la dernière carte du camp laïque alors que la crise économique s’aggrave et qu’un retour des islamistes commence à se profiler. Après l’arrestation en février 1999 du leader kurde, Abdullah Ocalan, considéré à cette époque comme « l’ ennemi public numéro un » et alors même que l’Union Européenne s’apprête à reconnaître enfin à la Turquie une vocation de candidate, Bülent Ecevit connaît une croissance de sa popularité qui n’est pas sans rappeler celle qui avait été la sienne dans les années 70. Lors des élections d’avril 1999, son parti est ainsi, avec 21,29% des voix, le premier parti de Turquie. Mais, à 75 ans, celui qui apparaît comme l’un des plus vieux routiers de la politique turque, est-il vraiment l’homme de la situation ? À nouveau, il se résout à une alliance hasardeuse et dirige un gouvernement de coalition qui l’associe au MHP, le parti d’extrême droite fondé par le Général Türkes, qui est en fait l’autre vainqueur (avec 17,25% des voix) des élections de 1999. Si certains lui reprochent aujourd’hui cette alliance surprenante, d’autres lui reconnaissent le mérite d’avoir maintenu dans le système cette force extrémiste et d’avoir contribué par là même à pacifier la vie politique turque. Toutefois, malgré les réformes importantes engagées pour favoriser l’intégration européenne de son pays et de la caution technique qu’apporte à son gouvernement la participation de l’ancien vice-président de la Banque mondiale, Kemal Dervis, Bülent Ecevit, diminué par la maladie, échoue dans son entreprise de stabilisation économique et de lutte contre la corruption. Les derniers mois de son gouvernement, qui voient son propre parti secoué par des dissensions internes, sont particulièrement difficiles et mettent sa coalition dans l’impossibilité de relever le défi que constitue désormais l’avènement de l’AKP. Les élections législatives de novembre 2002 qui voient la victoire sans appel de Recep Tayyip Erdogan sont une véritable sanction pour les partis au pouvoir et notamment pour le DSP qui n’obtient que 1,22% des voix. Le CHP, grand rival à gauche du DSP, est en dehors de l’AKP (avec un score de 19,39%) le seul parti représenté à la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Cet ultime revers écarte définitivement du pouvoir et de la vie politique ce leader charismatique dont la casquette et la moustache légendaires hantaient l’arène politique turque depuis plus de quarante ans.
Chemin faisant, bien qu’il ait pu paraître définitivement marginalisé à la fin des années 80, Bülent Ecevit va progressivement revenir, au cours de la décennie qui va suivre, au cœur d’une vie politique turque dont il connaît toutes les arcanes. Son parti entre ainsi au Parlement en 1991 avant de devancer (14,06% des voix et 76 sièges) le CHP à gauche, lors des élections législatives de 1995, remportées par les islamistes du Refah. Après « le coup d’État post-moderne » et la démission en 1997 du gouvernement dirigé par l’islamiste Necmettin Erbakan, le gouvernement de coalition des partis laïques dirigé par Mesut Yilmaz, dans lequel Bülent Ecevit est vice-premier ministre, est discrédité par les scandales et lui aussi congédié en 1998. Appelé à la tête d’un gouvernement de transition par son vieux rival Süleyman Demirel qui est devenu président de la République en 1993, Bülent Ecevit représente en quelque sorte la dernière carte du camp laïque alors que la crise économique s’aggrave et qu’un retour des islamistes commence à se profiler. Après l’arrestation en février 1999 du leader kurde, Abdullah Ocalan, considéré à cette époque comme « l’ ennemi public numéro un » et alors même que l’Union Européenne s’apprête à reconnaître enfin à la Turquie une vocation de candidate, Bülent Ecevit connaît une croissance de sa popularité qui n’est pas sans rappeler celle qui avait été la sienne dans les années 70. Lors des élections d’avril 1999, son parti est ainsi, avec 21,29% des voix, le premier parti de Turquie. Mais, à 75 ans, celui qui apparaît comme l’un des plus vieux routiers de la politique turque, est-il vraiment l’homme de la situation ? À nouveau, il se résout à une alliance hasardeuse et dirige un gouvernement de coalition qui l’associe au MHP, le parti d’extrême droite fondé par le Général Türkes, qui est en fait l’autre vainqueur (avec 17,25% des voix) des élections de 1999. Si certains lui reprochent aujourd’hui cette alliance surprenante, d’autres lui reconnaissent le mérite d’avoir maintenu dans le système cette force extrémiste et d’avoir contribué par là même à pacifier la vie politique turque. Toutefois, malgré les réformes importantes engagées pour favoriser l’intégration européenne de son pays et de la caution technique qu’apporte à son gouvernement la participation de l’ancien vice-président de la Banque mondiale, Kemal Dervis, Bülent Ecevit, diminué par la maladie, échoue dans son entreprise de stabilisation économique et de lutte contre la corruption. Les derniers mois de son gouvernement, qui voient son propre parti secoué par des dissensions internes, sont particulièrement difficiles et mettent sa coalition dans l’impossibilité de relever le défi que constitue désormais l’avènement de l’AKP. Les élections législatives de novembre 2002 qui voient la victoire sans appel de Recep Tayyip Erdogan sont une véritable sanction pour les partis au pouvoir et notamment pour le DSP qui n’obtient que 1,22% des voix. Le CHP, grand rival à gauche du DSP, est en dehors de l’AKP (avec un score de 19,39%) le seul parti représenté à la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Cet ultime revers écarte définitivement du pouvoir et de la vie politique ce leader charismatique dont la casquette et la moustache légendaires hantaient l’arène politique turque depuis plus de quarante ans.