
 |
 |

| L'impasse chypriote |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
En Turquie aujourd’hui, la question chypriote apparaît comme l’une des premières causes nationales (“milli dava”). C’est l’une des questions de politique étrangère (voire de politique intérieure pour certains...) où l’opinion publique turque a le plus de poids et sur laquelle “l’establishement politico-militaire” ne manque pas une occasion de s’exprimer. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au contraire, les revendications concernant, ce qu’on appelle communément en Turquie “l’enfant patrie” (“yavru vatan”), semblaient même avoir été abandonnées depuis le Traité de Lausanne, notamment après l’instauration de la République en 1923. On rappelle souvent, à cet égard, qu’une délégation chypriote turque, venue chercher, en 1950, un soutien auprès d’Ankara, lors des premières tensions intercommunautaires sur l’île, s’était faite éconduire purement et simplement. Les choses ont néanmoins rapidement évolué. Adnan Menderes, qui fait face à d’importants problèmes de politique intérieure, au milieu des années 1950, décide de détourner l’attention de l’opinion publique en survalorisant les questions de politique internationale. Les cousins turcs de l’île de Chypre dont les droits sont alors bafoués par les Chypriotes grecs arrivent à point nommé pour inaugurer cette tactique et épauler le développement du nationalisme turc sur l’île.
Avant d’en venir à la situation actuelle, il paraît fondamental de rappeler brièvement l’histoire tourmentée de l’île d’Aphrodyte. Chypre est conquise par les troupes ottomanes en 1571. Cette occupation se caractérise, comme dans les autres territoires ottomans, par la mise en oeuvre du système des millet1, qui permettra aux Chypriotes grecs de conserver leurs traditions culturelles, religieuses et linguistiques. En 1978, dans le contexte de la décadence ottomane, cependant, Chypre est cédée à l'Empire britannique. Cette cession se présente comme la contrepartie d'une alliance défensive contre la Russie et ne fait pas disparaître totalement la souveraineté ottomane sur l'île. La disparition de cette souveraineté n’intervient qu’en 1923, lors de la signature du Traité de Lausanne2, qui entérine en fait l'annexion de l'île à laquelle la Grande-Bretagne avait procédé, dès 1914. Chypre est par la suite proclamée colonie de la Couronne le 10 mars 1925. Et l’on peut considérer que le nationalisme chypriote grec apparaît à ce moment-là car il se construit en réalité en réaction à la colonisation britannique. Toutefois, ce n’est que dans les années 50 qu’un activisme grec anti-britannique prend corps, avec la création en avril 1955 de l’EOKA3, qui se fixe pour objectif de combattre les Britanniques et de les chasser de l’île. Le leader de ce mouvement indépendantiste chypriote grec est l'archevêque Makarios III4 qui allait devenir par la suite le premier Président de la République de Chypre. Du côté turc, c’est à partir des années 1950 que se développe l’idée selon laquelle Chypre a une importance cruciale pour la Turquie contemporaine. Sa position géostratégique est justifiée par les militaires. L’île se met alors à être couramment intégrée aux cartes turques et étudiée dans les manuels scolaires, sa situation intérieure est en permanence observée par les médias turcs. Tout est mis en oeuvre pour laisser croire que Chypre est en fait une province turque. A l’ “Enosis”, expression désignant la revendication par les Chypriotes grecques du rattachement de l’île à la Grèce qui s’inscrit dans la philosophie de la “Megali Idea”5, les Chypriotes turcs répondent par le mot d’ordre “Taksim” qui exprime leur souhait d’une partition de l’île. L’exacerbation des nationalismes de part et d’autre et bien sûr l’instrumentalisation du problème chypriote par la Turquie et par la Grèce vont contribuer au repli de chacune des communautés sur elle-même. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’en 1959, des négociations tripartites (entre la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie) se tiennent à Londres et à Zürich, l’espoir de parvenir à une entente négociée est déjà fortement compromise.
Les révisions constitutionnelles demandées par la partie grecque sont donc perçues par les Chypriotes turcs comme un indice du souhait des Grecs d’aboutir à “l’Enosis” en déstabilisant un système pourtant difficilement mis en place. L'archevêque Makarios aurait d’ailleurs admis à plusieurs reprises dans une interview au Times6 qu'il « était impossible aux Chypriotes grecs de renoncer à l'Enosis »7. Les treize amendements incriminés visaient en effet à changer le système bicommunautaire, certes imparfait mais qui plaisaient toutefois aux Turcs, pour le remplacer par un système majoritaire qui ferait bien évidemment la part belle aux Chypriotes grecs. La principale nouveauté était notamment l'abolition du droit de veto, par lequel les Chypriotes turcs parvenaient à faire bloquer depuis 1961 la levée des impôts. Ces amendements envisageaient aussi la suppression des quotas de nomination dans l’administration et dans l’armée qui étaient certes accordés de façon excessive à la partie turque (40% des quotas dans la police par exemple alors que la population turque s’élevait à moins de 20%) mais qui permettaient à ces derniers de se sentir prémunis contre une “tyrannie de la majorité”. Une des raisons essentielles de le crise de décembre 1963 découle aussi, selon certains analystes, de la consécration, par la Constitution de 1960, de deux nations distinctes. Le système aurait ainsi été voué à l'échec, dès son origine, dans la mesure où il ne serait guère soucié de construire une unité nationale, au-delà des deux communautés principales.... Lorsque l’on parle de la Constitution de 1960, on oublie souvent, en revanche, de rappeler qu’un Traité de Garantie a été signé au même moment entre la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne pour prévoir l’intervention d’un des trois garants en cas de menace grave contre l’indépendance ou la souveraineté de la République de Chypre. Ainsi, après les événements dits du “Noël sanglant”, fin 1963, la Turquie a une première fois été tentée d’intervenir à Chypre. Mais elle en sera finalement dissuadée par le Président américain Lyndon Johnson. La lettre adressée par ce dernier, le 5 juin 1964, à Ismet Inönü, apparaîtra néanmoins durablement comme le symbole d’une forte dépendance turque tant économique que politique à l’égard des Etats-Unis. Mais ce véto américain allait être cependant surmonté, dix ans plus tard… 3) Les interventions turques à Chypre de 1974
Dès le 22 juillet 1974, la Grèce et la Turquie acceptent le cessez-le-feu sur l’île demandé par l'ONU. Toutefois, pour la partie turque un règlement politique durable ne pouvait être assuré que par la réalisation de la phase II du plan qui était prévu avant même la tenue des opérations. Beaucoup de villages turcs étaient encore assiégés ou occupés par les forces de la Garde Nationale grecque. D'après la plupart des analystes européens, les militaires étaient alors, en Turquie, les maîtres de la situation et cherchaient à gagner du terrain pour progresser davantage vers le Sud de l’île et donner une assise territoriale conséquente à une éventuelle administration turque... Bülent Ecevit, laissant une marge de manoeuvre assez importante à l'institution militaire, une seconde intervention de l’armée turque survient le 14 août 1974. Celle-ci est cette fois condamnée par la communauté internationale. Si la partie turque insiste sur le fait que cette seconde intervention était prévue à l’origine, le doute est toutefois permis et laisse à penser qu’elle découla plutôt de l’échec des négociations qui se déroulaient alors à Genève... Il n’en reste pas moins que l’intervention d’août 1974 constitue une grave erreur stratégique qui isolera et discréditera complètement la Turquie.
5) Le tournant de 2004 ? Depuis la fin des années 90, plusieurs événements ont contribué à changer la donne et à faire sortir le conflit chypriote de la léthargie dans laquelle il était tombé depuis de longues années. Citons les pour mémoire avant de revenir sur certains d’entre eux :
6) La corrélation entre les agendas européen et chypriote de la Turquie Toutefois, à y regarder de plus près, cette distance paraît quelque peu relative. Ainsi, au moment-même ou il signe, après de nombreux revirements, le protocole étendant l’accord d'Union douanière avec l'Union européenne aux dix nouveaux Etats membres de cette dernière dont bien evidemment Chypre, le gouvernement turc publie une déclaration rappelant que cette signature ne signifie pas une reconnaissance de la République de Chypre. Le gouvernement AKP, pris en étau entre l’opinion publique et l’Etat-major, d’une part et l’Union européenne, d’autre part, a en fait répondu par une sorte de “oui mais” qui débouche sur une politique timide qui sera jugée insuffisante par les diplomates européens et inacceptable par les Chypriotes grecs. Après plusieurs concessions annoncées mais non réalisées du côte turc, le différend chypriote a finalement conduit à la suspension partielle des négociations d’adhésion de la Turquie, en décembre 2006, sous la présidence finlandaise après une proposition de la Commission en ce sens, le 29 novembre 2006. Aucun compromis, en particulier sur l'ouverture des ports et aéroports turcs aux navires et avions en provenance de Chypre (requise par le protocole d'Ankara) n’a finalement été accepté. Se sont ainsi trouvés bloqués 8 chapitres sur les 35 nécessaires à la reprise de l’acquis communautaire. Ces chapitres concernent le commerce, la libre circulation des biens, les services et les services financiers, l’union douaniere, l’agriculture, la pêche, les transports et les relations extérieures. Le 29 mars 2007, les Vingt-Sept ont pourtant relancé les pourparlers d'adhésion de la Turquie à l'UE qui étaient au point mort depuis neuf mois. La discussion porte désormais sur le chapitre "Entreprise et politique industrielle". Aucun chapitre ne sera cependant refermé tant que la Turquie ne respectera pas le protocole d'Union douanière qu'elle a signé en juillet 2005. La question chypriote, en particulier les problèmes politiques et institutionnels auxquels a mèné la non-reconnaissance d’un Etat qui est désormais membre de l’Union européenne, constitue une épée de Damoclès qui pèse désormais en permanence sur le bon déroulement du processus de négociations en vue de l’adhésion. La récente ouverture d’un point de passage par les Chypriotes grecs dans le mur de Nicosie a laissé croire que les négociations intercommunautaires allaient reprendre mais il n’en est rien. Depuis 2004, la situation est donc bloquée et ce ne sont pas des gestes symboliques comme celui-ci ou encore comme la déclaration de la Turquie relative à l’ouverture d’un port ou d’un aéroport aux Chypriotes grecs, qui pourront faire significativement évoluer la situation. Par ailleurs, comme l'explique Carlos de Cueto, "conflit intra étatique à l'origine, la question chypriote est devenue un problème interétatique, un conflit internationalisé, en raison de l'interdépendance et de l'interaction entre de nombreux États et organisations internationales" et cette internationalisation du conflit, qui a entraîné une multiplication des acteurs, rend plus difficiles encore la résolution d’un conflit domestique. En outre, l’instrumentalisation de la question chypriote par la Grèce et par la Turquie sur leurs scènes politiques intérieures respectives a des conséquences désastreuses car elle entraîne le report des négociations à une date postérieure aux échéances électorales qui sont prévues dans les deux pays. Emel Kaba
CHRONOLOGIE La présence turque à Chypre
1Le terme "millet" signifie "nation" en turc. Le système du millet, sous l'Empire ottoman,désigne ce qui permettait aux minorités religieuses, à condition qu'elles soient monothéistes, d'organiser leurs droits et libertés de culte. Dans la mesure où la conversion à l'Islam n'était pas forcée, les minorités -parmi lesquelles les Arméniens, les Chrétiens orthodoxes grecs, les Chrétiens latins (soit les Catholiques romains) et les Juifs qui sont officiellement reconnus- pouvaient adopter leurs propres codes juridiques par exemple et également avoir leurs propres écoles religieuses. En revanche, puisqu'ils étaient ainsi, contrairement aux Musulmans, exemptés de service militaire, ils devaient s'acquitter d'impôts. 2A ce sujet, il faut noter que les commentateurs turcs soulignent le fait que la Grèce, autant que la Turquie, dans le Traité de Lausanne, reconnaissait l'annexion de l'île par la Grande- Bretagne. 3 Un peu plus tard, sera crée également l’EOKA-B, organisation armée dirigée contre les Chypriotes turcs cette fois. 4 Mikhaïl Khristodoulos Mouskos, dit Makarios III, est né en 1913 et mort le 3 août 1977 à Nicosie. Il a été archevêque et primat de l'Église orthodoxe autocéphale de Chypre de 1950 à sa mort. Après avoir été élu Président en décembre 1959, il lutta pour l'indépendance de Chypre qu'il obtint le 16 août 1960 et figure parmi les membres actifs de l'organisation armée EOKA. A cet égard, il est également connu pour avoir su jouer sur les deux fronts que sont la lutte anti-coloniale dans le cadre de l'EOKA -qui visait à terme le rattachement à la Grèce- et le Mouvement des Non-alignés pour obtenir l'indépendance de l'île, ce qui lui valut le surnom de "Castro de la Méditerranée" de la part des Américains. 5 “Megali Idea” : la Grande Idée. Principe pan-hélleniste exprimé pour la première fois par le parlementaire Ioannis Kolettis en 1844 qui vise la réunion de tous les Grecs. 6 The Times, 9 avril 1963. 7 Oglun, Ergün, cité dans l'article "Chypre : mythes, réalités objectives et avancées possibles" paru dans la Revue Outre-terre n°10, de mars 2005. 8 Ce rapprochement est en grande partie le résultat des contacts tant gouvernementaux que civils qui ont été établis au cours de l'année 1999. Le tremblement de terre qui a touché la ville d'Istanbul le 17 août 1999 renforce ce rapprochement qui avait été amorcé par le cycle de réunions bilatérales entre les deux ministres des affaires étrangères Giorgios Papandréou (fils) et Ismail Cem en février 1999. |

| © 2007 L. Schirmeyer |


 La République de Chypre qui voit le jour le 16 août 1960 peut être définie comme une République de compromis. Sa Constitution, en effet, a été le fruit de longues et laborieuses négociations entre les différentes parties (britanniques, grecques et turques) mais sa durée de vie sera des plus courtes. Dès la fin de l’année 1963, les treize amendements que propose Monseigneur Makarios au vice-Président chypriote turc d’alors, Fazil Küçük, provoquent une crise grave et aboutissent à la suspension de facto du régime qui venait d’être établi et de sa Constitution. Le sentiment que des droits excessifs (leur permettant notamment de s'opposer à l'engagement de la moindre réforme visant à modifier le système bi-communautaire) avaient été accordés à la communauté chypriote turque va prévaloir à partir de cette époque, chez les Chypriotes grecs. Ce sentiment se perpétuera et il est encore aujourd'hui souvent utilisé par la propagande chypriote grecque pour expliquer l'échec du système fondé en 1960. Quant au côté turc, ils considèrent que l’instabilité institutionnelle justifiant la réforme proposée par les Grecs n'était qu'un prétexte avancé par Makarios pour couvrir son profond désir “d'Enosis”.
La République de Chypre qui voit le jour le 16 août 1960 peut être définie comme une République de compromis. Sa Constitution, en effet, a été le fruit de longues et laborieuses négociations entre les différentes parties (britanniques, grecques et turques) mais sa durée de vie sera des plus courtes. Dès la fin de l’année 1963, les treize amendements que propose Monseigneur Makarios au vice-Président chypriote turc d’alors, Fazil Küçük, provoquent une crise grave et aboutissent à la suspension de facto du régime qui venait d’être établi et de sa Constitution. Le sentiment que des droits excessifs (leur permettant notamment de s'opposer à l'engagement de la moindre réforme visant à modifier le système bi-communautaire) avaient été accordés à la communauté chypriote turque va prévaloir à partir de cette époque, chez les Chypriotes grecs. Ce sentiment se perpétuera et il est encore aujourd'hui souvent utilisé par la propagande chypriote grecque pour expliquer l'échec du système fondé en 1960. Quant au côté turc, ils considèrent que l’instabilité institutionnelle justifiant la réforme proposée par les Grecs n'était qu'un prétexte avancé par Makarios pour couvrir son profond désir “d'Enosis”.  La première intervention a lieu le 20 juillet 1974. Elle sera en général acceptée par la communauté internationale car elle conduira à l'effondrement du régime des Colonels, en Grèce, et à l'échec du coup d'État tenté par Nicos Sampson, à Chypre. En outre, le Premier ministre Bülent Ecevit, qui gagnera à cette occasion le surnom populaire de “Karaoglan” (allusion à un héro turc populaire), avait conçu d’agir à l’origine en collaboration avec le “Foreign Office” mais il devra finalement intervenir seul, suite au refus du Premier ministre britannique, Harold Wilson.
La première intervention a lieu le 20 juillet 1974. Elle sera en général acceptée par la communauté internationale car elle conduira à l'effondrement du régime des Colonels, en Grèce, et à l'échec du coup d'État tenté par Nicos Sampson, à Chypre. En outre, le Premier ministre Bülent Ecevit, qui gagnera à cette occasion le surnom populaire de “Karaoglan” (allusion à un héro turc populaire), avait conçu d’agir à l’origine en collaboration avec le “Foreign Office” mais il devra finalement intervenir seul, suite au refus du Premier ministre britannique, Harold Wilson. 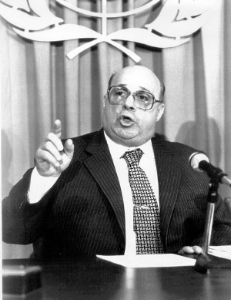 Peu après la fin de l’intervention, des échanges de population sont préparés et enterrinés par les Accords de Vienne du 2 août 1975. A partir de ce moment-là, tout est fait pour que les deux communautés de l’île ne se soient plus en contact. Une administration autonome turque, dirigée alors par un jeune avocat, Rauf Denktas, voit le jour. Quelques années plus tard, plus exactement le 15 novembre 1983, ce même Rauf Denktas proclame la République turque de Chypre Nord (RTCN) qui ne sera jamais reconnue par la communauté internationale et dont il restera le principal dirigeant jusqu’en 2005... Cette personnalité, qui gagnera progressivement le surnom de “Mister No” en raison de son opposition quasi-systématique à tous les plans de réunification proposés, incarne bien l’isolation et l’immbolisme dont sera au bout du compte victime la population chypriote turque pendant près de trois décennies.
Peu après la fin de l’intervention, des échanges de population sont préparés et enterrinés par les Accords de Vienne du 2 août 1975. A partir de ce moment-là, tout est fait pour que les deux communautés de l’île ne se soient plus en contact. Une administration autonome turque, dirigée alors par un jeune avocat, Rauf Denktas, voit le jour. Quelques années plus tard, plus exactement le 15 novembre 1983, ce même Rauf Denktas proclame la République turque de Chypre Nord (RTCN) qui ne sera jamais reconnue par la communauté internationale et dont il restera le principal dirigeant jusqu’en 2005... Cette personnalité, qui gagnera progressivement le surnom de “Mister No” en raison de son opposition quasi-systématique à tous les plans de réunification proposés, incarne bien l’isolation et l’immbolisme dont sera au bout du compte victime la population chypriote turque pendant près de trois décennies.  Il convient de souligner en particulier le tournant qu'ont représenté les résultats du référendum du 24 avril 2004 sur le plan Annan de réunification de l’île. En effet, la responsabilité qui incombait entièrement à la partie turque, du fait de l'intervention de 1974, a pu être enfin un peu atténuée.
Il convient de souligner en particulier le tournant qu'ont représenté les résultats du référendum du 24 avril 2004 sur le plan Annan de réunification de l’île. En effet, la responsabilité qui incombait entièrement à la partie turque, du fait de l'intervention de 1974, a pu être enfin un peu atténuée.